Reconnaître la dépression chez le jeune enfant
- serazincassandre
- 13 févr. 2021
- 7 min de lecture
Dernière mise à jour : 17 sept. 2021
Cassandre SERAZIN
psychologue clinicienne, psychothérapeute, art-thérapeute
Il est difficile d'admettre qu'un enfant puisse ne pas être heureux, qu'il puisse être profondément triste. Ces croyances et préjugés moraux autour de cette problématique ont longtemps empêché la reconnaissance du diagnostic de dépression chez le jeune enfant (André, 1989 ; Sandler & Joffe, 1967). Ignorée voire niée, « aujourd’hui, non seulement la réalité des pathologies dépressives de l’enfance est admise, mais leur statut est devenu une question centrale en psychopathologie de l’enfant » (Arbisio, 2003).
Si le trouble n'est pas reconnu, outre la souffrance persistante de l’enfant, les symptômes peuvent entraîner des difficultés dans son développement, une désadaptation progressive venant confirmer les comportements de dévalorisation de l'enfant et accentuer les difficultés de compréhension entre parent et enfant (Marcelli, 2003).

LES CHIFFRES
Après avoir longtemps été méconnu, voire nié, on observe une véritable inflation du diagnostic de dépression chez l'enfant, dès les années 1970 (Arbisio, 2003), pouvant aller jusqu’à 17,5% de symptômes dépressifs chez des enfants de 6 à 11 ans (Valla, Bergeron, 1997).
Depuis, une revue de la littérature synthétisant les résultats de treize études est venue confirmer la rareté de ce diagnostic (Guillaud-Bataille, Cialdella, 1993). On retrouve une prévalence de la dépression variant entre 0,5% et 2% selon les recherches, avec des manifestations dépressives plus importantes chez les garçons que chez les filles qui ont moins tendance à extérioriser leur souffrance et donc ne posent pas de problèmes de comportement (Nashat, 2006), jusqu’à la puberté.

LES SIGNES CLINIQUES
Chez le jeune enfant, les manifestations affectives évoquant la dépression sont rares. Cependant, les études à ce sujet se regroupent autour de la récurrence des symptômes suivants (Dugas & Mouren, 1980 ; Weinberg & al., 1983 ; Ajuriaguerra & Marcelli, 1984) :
Un affect de tristesse : l'enfant est parfois malheureux mais n'est pas nécessairement en mesure de l'exprimer ou il peut être perçu comme particulièrement « sérieux » (Sandler & Joffe,1967 ; Papazian & al, 1992).
Des troubles du comportement : l'agitation et l'instabilité sont fréquentes chez l'enfant avec des expressions agressives (conduites de protestation, de revendication face à l’état de souffrance, d’opposition, de bouderie, de colère ou même de rage, manifestations agressives et auto-agressives, possibilité de conduites « délinquantes ») (Arbisio, 2003 ; Marcelli, 2003). Ces comportements, entraînant fréquemment des plaintes de la famille ou de l'école qui perçoivent l'enfant comme étant instable ou caractériel, peuvent être le principal motif de consultation (Arbisio, 2003 ; Marcelli, 2003).
Des sentiments négatifs : d’indignité, de perte d’amour, de dévalorisation et de culpabilité sont très présents (Papazian & al., 1992 ; Arbisio, 2003 ; Marcelli, 2003) et peuvent entraîner des conduites auto-punitives : blessures ou accidents à répétition, punitions incessantes à l’école, etc. (Arbisio, 2003).
Une sensibilité exacerbée aux imperfections : expression fréquente de l'insatisfaction, de la thématique de l’échec par des commentaires négatifs et de l'incapacité à réaliser (Arbisio, 2003 ; Marcelli, 2003).
Un repli sur soi : l'enfant peut exprimer une certaine passivité, se tenir en retrait du monde extérieur ou exprimer de l'ennui et montrer une tendance au repli sur des activités auto-érotiques (Sandler & Joffe, 1967 ; Marcelli, 2003). L’échec, les phobies scolaires, ainsi que l’absentéisme à l’école, sont également à considérer (Arbisio, 2003).
Des idées de mort ou de suicide : le thème de la mort envahit les productions (dessins, histoires, etc.) ou peut être exprimé directement, ce qui peut motiver la consultation (Arbisio, 2003 ; Marcelli, 2003).
Un rapport particulier à la possession : l'enfant peut commettre des petits vols, collectionner les « trésors » ou perdre fréquemment ses affaires (Marcelli, 2003).
Des symptômes somatiques : les maux de ventre et les maux de tête, les troubles du sommeil, de l’alimentation, digestifs sont fréquents, mais peuvent aussi bien être l'expression d'une composante anxieuse que dépressive (Arbisio, 2003).
Des difficultés à penser : l'enfant peut présenter des difficultés à penser, à fixer son attention, à se concentrer et à investir une activité, pouvant s'exprimer par un refus ou évitement du travail scolaire ou de longues heures passées sur une activité de façon inefficace (Arbisio, 2003 ; Marcelli, 2003).
LES EXPLICATIONS
« Qu’il s’agisse de l’environnement familial ou des événements de vie, en dehors du rôle néfaste de leur cumul, il ne semble pas exister de corrélations particulières entre ces événements, leur succession et l’évolution de l’épisode dépressif » (Goodyer et coll., 1997). L'expression de la dépression chez l'enfant peut être expliquée par plusieurs facteurs :
Le rapport à la perte et/ou à la séparation (Gourdon-Hanus, 1980 ; Marcelli, 2003)

La perte peut être réelle avec des effets durables (décès d’un proche, séparation brutale et complète par disparition de l’un des proches ou par éloignement de l’enfant lui-même) ; temporaire mais suscitant une angoisse d’abandon persistante au-delà du retour à la situation normale (maladie, absence momentanée d’un des parents, etc.) ; fantasmatique ou « interactive » (sentiment de ne plus être aimé, d’avoir perdu la possibilité de contact avec un proche, que le parent n’est plus disponible au plan psychique ou accaparé par un conflit).
L’événement est d’autant plus traumatisant pour l’enfant que son environnement ne lui apporte pas de repères persistants (changement de cadre, disparition de la fratrie, etc.). D'autre part, cette perte peut apparaître plus banale pour une perception d'adulte (déménagement, mort d'un animal de compagnie, éloignement d'un camarade, etc.).
L'environnement parental (Marcelli, 2003)
L'environnement et le comportement parental influence le développement psychologique global de l'enfant, la perception qu'il a de lui-même et son l'équilibre psychologique. C'est le cas notamment de la fréquence d’antécédents de dépression ou de pathologie associée chez les parents, entraînant frustration et culpabilité chez l'enfant, par un mécanisme d’identification au parent déprimé et un sentiment que le parent est à la fois inaccessible et indisponible et qu’en même temps l’enfant est lui-même incapable de le consoler, de le gratifier ou de le satisfaire. De même, la fréquence de la carence parentale (dévalorisation, agressivité, hostilité ou indifférence totale, rejet complet) peut être à l'origine des symptômes dépressifs, comme c'est plus rarement le cas d'une excessive sévérité éducative suscitant chez l’enfant la constitution d’une instance particulièrement sévère et impitoyable vis-à-vis de lui-même.
Les comorbidités
La dépression chez le jeune enfant présente de nombreuses comorbidités : troubles anxieux (30 à 75 %), troubles oppositionnels (21 à 83 %), trouble déficitaire de l’attention avec ou sans instabilité (0 à 57 %), etc. (Angold & Costello, 1993 ; Marcelli, 2003). D'autre part, un diagnostic différentiel doit être fait afin d'éliminer d'autres causes présentant une proche symptomatologie, telle que l'existence d'une douleur chronique (Marcelli, 2003). De même, identifier une possible précocité permet d'expliquer et de prévenir certains comportements (Revol & al., 2004). En effet, les enfants à haut potentiel intellectuel peuvent présenter des troubles psychologiques très variés, comme l’anxiété et la dépression, justifiant une prise en charge spécialisé (Kermarrec, 2017).

LES SOLUTIONS
Repérer la dépression & Reconnaître la souffrance de l'enfant
L'accompagnement de l'enfant commence par « la reconnaissance de la dépression et l’identification empathique à la souffrance de l’enfant » (Marcelli, 2003). La valeur thérapeutique de celle-ci est d'autant plus grande qu'elle permet l'intégration des parents dans le processus de soin de l'enfant, par des aménagements relationnels. En effet, l'énonciation du diagnostic est un levier thérapeutique essentiel à la prise en soin de l'enfant et à la levée des symptômes.
Veiller à ne pas stigmatiser l'enfant
Afin de favoriser le rétablissement, il est impératif de veiller à ne pas entrer dans un processus de désignation pathologique de l’enfant, qui pourrait aggraver les symptômes, d'autant que le diagnostic de dépression ne préjuge pas de son organisation structurelle (Marcelli, 2003). La symptomatologie dépressive chez l’enfant étant fondamentalement relationnelle et interactive (Arbisio, 2003), une attitude de compréhension empathique sera particulièrement efficace (Marcelli, 2003).
Mettre en place une prise en charge psychothérapeutique
La prise en charge psychothérapeutique est nécessaire, dès lors que l’organisation psychodynamique de l’enfant est menacée. Cet accompagnement est fondamental au rétablissement, dans la mesure où l’enfant et son entourage familial se saisissent de la démarche et se sentent capable de la conduire jusqu'à son terme. La psychothérapie peut porter sur l’enfant ou sur son environnement, selon la nature du trouble (épisode dépressif d’allure réactionnelle ou maladie dépressive) et l'importance relative des facteurs internes et externes à l'enfant.
Une prise en charge médicamenteuse n'est pas indiquée chez le jeune enfant car son effet, bien que non négligeable dans le cas d'une rupture de l'abord relationnel, n'est souvent que transitoire (Marcelli, 2003).

Bibliographie :
Ajuriaguerra, J. & Marcelli, D. (1984). Psychopathologie de l’enfant, 2ème éd. revue et complétée, Masson, Paris.
André, P. (1989). La dépression chez l'enfant: aspects cliniques et thérapeutiques. Journal De Pédiatrie Et De Puériculture, 2(4), 216-220. doi: 10.1016/s0987-7983(89)80154-9
Angold A. & Costello E. (1993). « Depressive comorbidity in children and adolescents : Empirical theoretical and methodological issues », Am. J. Psychiatry 1993 ; 150, 12 : 1779-1791.
Arbisio, C. (2003). Le diagnostic clinique de la dépression chez l'enfant en période de latence. Psychologie clinique et projective, 1(1).
Cytryn L. & Mac Knew D.H. (1974). « Factors influencing the changing clinical expression of the depressive process in children », American Journal of Psychiatry, n° 131, p.879-881.
Dugas M. & Mouren M.-C. (1980). Les troubles de l’humeur chez l’enfant de moins de 13 ans, PUF, Paris.
Freud S. (1905). Trois essais sur la théorie sexuelle, Gallimard, Paris, 1987.
Gourdon-Hanus, D., Hanus, M. & Jassaud, R. (1980). « Le deuil chez l’enfant », Psychiatrie Enf. 1980 ; 23, 1 ; 319-340.
Guillaud-Bataille, J.-M. & Cialdella, P.-H. (1993). « Epidémiologie des troubles dépressifs chez l’enfant et l’adolescent. Revue de la littérature. », Neuropsychiatrie de l’Enfance, n° 41, p.175-184.
Kermarrec, S. (2017). Relations entre potentiel intellectuel, anxiété et dépression chez l'enfant (Thèse de doctorat en Sciences cognitives). École doctorale Cognition, comportements, conduites humaines de Boulogne-Billancourt.
Kielholz, P. (1973). La dépression masquée, Masson, Paris.
Kovacs M., Devlin B., Pollock M., Richards C. & Mukerji P. (1997). « A controlled family history study of childhood-onset depressive disorder », Arch. Gen. Psychiatry 1997 ; 54 : 613-623.
Marcelli D. (1997), « Quels sont les signes cliniques des troubles dépressifs chez l’enfant ? », in Conférence de consensus : Les troubles dépressifs chez l’enfant, Editions Frison-Roche, Paris, 1997, p.15-24.
Marcelli, D. (2003). Dépression de l'enfant. Psychologie clinique et projective, 1(1), 59-78. https://doi.org/10.3917/pcp.009.0059
Nashat, S. (2006). Quelques éléments de réflexion sur la dépression chez l'enfant : à partir et au-delà de la position dépressive. Journal français de psychiatrie, 3(3), 15-17. https://doi.org/10.3917/jfp.026.0015
Palacio-Espasa F. & Dufour R. (1995). Diagnostic structurel chez l’enfant, Masson, Paris.
Papazian B., Manzano J. & Palacio Espasa F. (1992). « Les syndromes dépressifs chez l’enfant. Fonction de la source d’informations et du mode d’investigation », Neuropsychiatrie de l’Enfance, 40, 1, p. 1-12.
Revol, O., Louis, J. & Fourneret, P. (2004). L'enfant précoce : signes particuliers. Neuropsychiatrie De L'enfance Et De L'adolescence, 52(3), 148-153. doi: 10.1016/j.neurenf.2003.10.004
Sandler J. & Joffe M.G. (1967). « Remarques sur la souffrance, la dépression et l’in-dividuation », Psychiatrie de l’enfant, vol. 10, p. 123-156.
Tood, R.D., Geller, B., Rosalind, M., Fox, L.W. & Hickok, J. (1996). « Increased prevalence of alcoholism in relatives of depressed and bipolar children » J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 1996 ; 35-6 : 716-724.
Valla, J.P. & Bergeron, L. (1997). « Quelles sont la fréquence et la distribution des troubles dépressifs et de leurs complications chez l’enfant ? », in Conférence de consensus : Les troubles dépressifs chez l’enfant, Editions Frison-Roche, Paris, 1997, p.77-93.
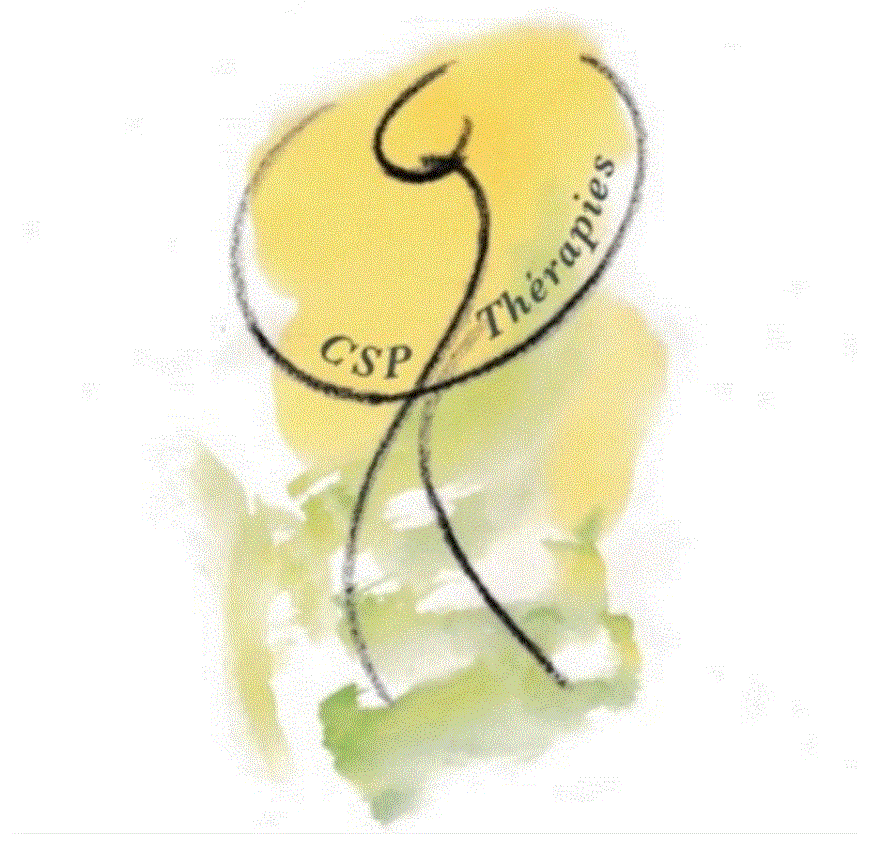



Commentaires